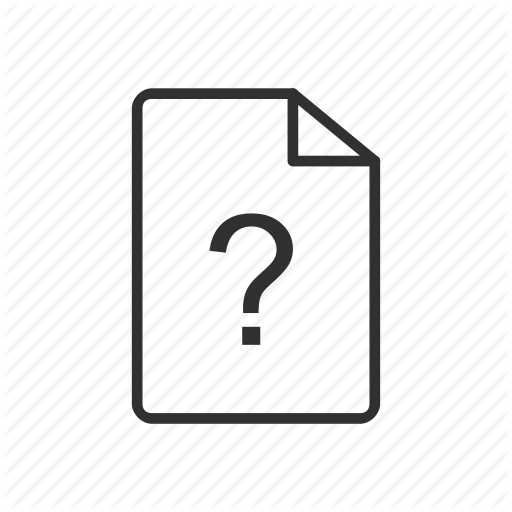Corps Etrangers
Création / Théâtre de la Tempête / 17 janv - 16 fev
Collecte Terminée
1 500,00 €
soutiennent
objectif de
ARTS DE LA SCÈNE
Présentation du projet
> Résumé
Pendant plus de trente ans, Hunter, anatomiste, suit et fait suivre O’Well, l’homme tranquille, dont l’immense silhouette le fascine. Comment, en ce géant, s’articulent chair et os ? A-t-il une âme, est elle semblable à celle des autres ? Mais le grand bossu tarde à mourir… Quand enfin on allonge la dépouille d’O’Well sur la table de dissection, le corps ne révèle rien, sinon l’aveuglement et la cruauté du scientifique qui prétend comprendre l’être humain en le désarticulant comme un pantin. L’illusion fait place à la mélancolie et ouvre sur la folie… Dans ce texte récent, Stéphanie Marchais met en jeu une galerie de personnages odieux ou attachants : science et démence infiltrent le monde, mais le mystère demeure de ce qui fait un homme : « Ce n’est pas ainsi, Monsieur, que l’on approche le secret d’une vie ! » déclare, post-mortem, notre géant, figure de l’étranger, dont la singularité révèle ou suscite tant de bêtise et de cruauté. Dans l’univers scénique de ce conte, le fantastique des peurs primitives côtoie la sophistication technologique : entre humour et inquiétude, frissons de crainte et de plaisir…
> Les informations sur le site du Théâtre de la Tempête (cliquer sur le lien)
> Présentation du spectacle par Thibault Rossigneux à la présentation de saison du Théâtre de la Tempête en juin 2013 (cliquer sur le lien pour accéder à l'extrait vidéo)
> Bande-annonce (cliquer sur le lien)

> Pourquoi porter 'Corps Etrangers' à la scène ?
« Tout d’abord parce que cette apologie de la différence me semble plus que jamais être un combat d’actualité. L’usage de la métaphore du géant, comme représentant de “l’étranger” permet de dénoncer l’intolérance et la bêtise qui vont souvent de paire. À l’instar de la partition proposée par l’auteure, je souhaite raconter cette fable avec tout l’imaginaire qu’elle véhicule, tout en étant le vecteur d’un discours engagé. Il ne s’agit pas de proposer un théâtre partisan, mais par touches diffuses, d’interroger la question de l’identité, du rapport à l’autre, de l’acceptation ou du rejet de la différence... Étrangeté dramaturgique où nous perdons nos repères. La mise en scène accompagne ce trouble. La mort est ici synonyme de lumière et de fougue alors que les protagonistes bien vivants sont eux englués dans un magma moribond. »
Thibault Rossigneux
A quoi sert l'argent collecté
Votre participation nous aidera à nous procurer le matériel technique nécessaire (principalement caméras et vidéoprojecteurs) à la réalisation du travail vidéo autour de l'illusion, axe de travail que souhaite développer Thibault Rossigneux, metteur en scène, pour accompagner la magie du texte de Stéphanie Marchais et pour lequel il s'est entouré de Xavier Hollebecq et Rachel Marcus la pour scénographie et les lumières et d'Arthur Gordon et Ugo Mechri pour la vidéo.
Objectif de collecte
1 500,00 €
Montant Global
0,00 €
| Désignation | Montant |
|---|---|
TOTAL |
|
| TOTAL | 0,00 € |
| Désignation | Montant |
|---|---|
Proarti |
|
| Financement participatif proarti | 1 500,00 € |
TOTAL |
|
| TOTAL | 1 500,00 € |
C’est un monde en clair-obscur, comme si tout se passait dans une nuit sans limite, un monde d’ombres augmentées, celui de la « peur délicieuse » dont le cinéma expressionniste donnerait le climat.
C’est un monde d’observation scientifique, avec ses changements d’échelle, sa lumière crue, son regard froid ; un monde aux frontières poreuses entre vie et mort, passé et présent, organique et technologique
; un monde où le mort saisit le vif et le vif l’inerte…
C’est un monde où voisinent science et folie et qui laisse affleurer le mystère, source de trouble et d’émoi. Je souhaite traduire scéniquement l’imaginaire que cette fable porte. Chaque personnage a sa démesure, intérieure ou extérieure, physique ou mentale.
L’étrangeté des situations est abordée avec simplicité, voire naturel : la jeune fille morte jouit d’une belle santé et sa partition, poétique, la porte spontanément au chant…
La quête d’Hunter, pour folle qu’elle soit, est sincère et crédible ; O’Well, le lunaire, s’adresse avec la même conviction à son voisin qu’à sa fille décédée : le décalage et le trouble naissent non pas de l’interprétation
mais de la juxtaposition des séquences, et des procédés que nous empruntons au cinéma : plan large pour les actions simultanées
et parallèles, plan serré focalisant sur un détail…
Pour interpréter le personnage de la femme rousse, il est fait appel à un robot humanoïde utilisé par l’institut Ilumens dans le cadre de la formation des médecins : il pleure, saigne, frémit… et permet ainsi de réagir à des situations d’urgence.
Ces tableaux froids en noir et blanc contrastent avec l’humour propre à chaque personnage : désabusé chez O’Well, méprisant chez Hunter, sarcastique chez Mac Moose, cru chez la jeune fille de dix ans, spontané chez Molly…
Le géant représente l’étranger. Ce plaidoyer en faveur de la différence me semble plus que jamais relever d’un combat d’actualité, et je souhaite interroger, par petites touches, la question de l’identité, du rapport à l’autre, de l’acceptation ou du rejet de la différence.
Thibault Rossigneux
Contreparties
La basique
pour 10,00 € et +
1 ARTINAUTE
Merci !
Votre nom figurera sur notre site internet !
La goodie
pour 25,00 € et +
1 ARTINAUTE
149 DISPONIBLES
Merci !
Votre nom figurera sur notre site internet
+ une affiche dédicacée par l'ensemble de l'équipe vous sera envoyée, accompagnée d'ungoodieles sens des mots (indice : il décorera votre frigo)
L'amicale
pour 50,00 € et +
0 ARTINAUTES
Merci !
Votre nom figurera surnotre site internet
+ungoodieles sens des mots
+ une invitation à la représentation de votre choix et des places autarif ami (10 € au lieu de 18€) pour lespersonnes vous accompagnant
La festive
pour 75,00 € et +
0 ARTINAUTES
Merci !
Votre nom figurera surnotre site internet
+ungoodieles sens des mots
+ des places autarif ami (10 € au lieu de 18€) pour lespersonnes vous accompagnant
+ une invitation pour vous à la dernière représentation et àsa festive et traditionnelle"soirée de dernière" le dimanche16 février 2014
La curieuse
pour 100,00 € et +
0 ARTINAUTES
Merci Merci !
Votre nom figurera surnotre site internet
+ungoodieles sens des mots
+ des places autarif ami (10 € au lieu de 18€) pour lespersonnes vous accompagnant
+ une invitation pour vous (date à fixer avec les autres donateurs) précédée d'une visite du Théâtre de la Tempête avec les équipespour mieux comprendre l'envers du décor
La littéraire
pour 125,00 € et +
0 ARTINAUTES
Merci Merci !
Votre nom figurera surnotres site internet
+ungoodieles sens des mots
+une invitation à la représentation de votre choix
+des places autarif ami (10 € au lieu de 18€) pour lespersonnes vous accompagnant
+ un exemplaire du texte Corps Etrangers dédicacé à l'occasion d'unerencontre privilégiée avec l'auteure et le metteur en scène pour mieux comprendre le chemin de cettecréation
La robotique
pour 150,00 € et +
3 ARTINAUTES
12 DISPONIBLES
Un merci géant !
Votre nom figurera surnotre site internet
+ungoodieles sens des mots
+ une invitation à la représentation de votre choix
+ des places autarif ami (10 € au lieu de 18€) pour lespersonnes vous accompagnant
+ une visite privée du laboratoire de simulation médicaleilumens à l'Université Paris-Descartesavec son directeur, Antoine Tesnière, pour découvrir le fonctionnement des robotshumanoïdes et leur application dans le champ médical